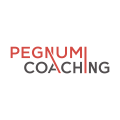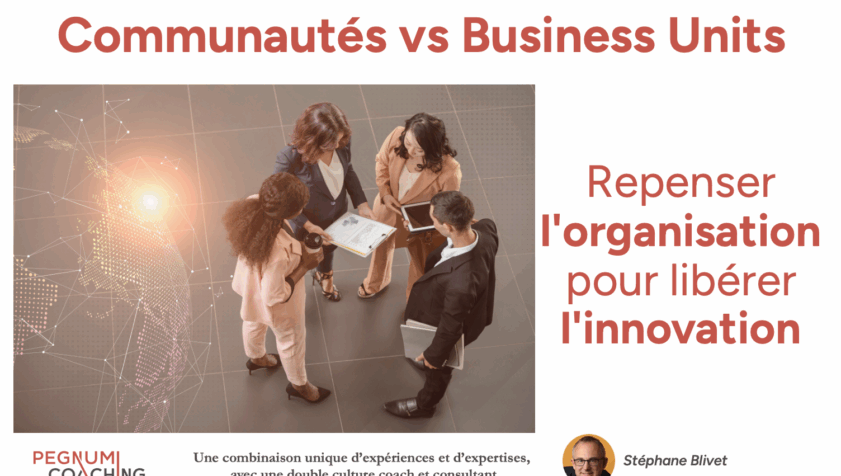Qu’est-ce qui fait qu’un collectif parvient à transcender la somme des individualités, à créer ensemble ce qu’aucun n’aurait pu produire seul ?
Cette question est au cœur de nos sociétés (pourquoi la conscience écologique ne se transforme pas en actes?), je vous propose de regarder aujourd’hui ce phénomène dans le contexte des communautés d’entreprise.
La question peut également être formulée de cette façon : pourquoi nos structures organisationnelles traditionnelles peinent-elles à générer l’innovation et l’agilité dont nous avons besoin ?
La réponse pourrait bien résider dans cette opposition entre deux modèles : d’un côté, les structures classiques (directions, business units, équipes hiérarchiques), de l’autre, les communautés organiques qui émergent autour d’un projet partagé.
Le piège des silos organisationnels
Les business units, par essence, optimisent leur performance autour d’objectifs spécifiques : chiffre d’affaires, parts de marché, rentabilité. Cette logique mécaniste crée naturellement des frontières étanches : chacun protège son territoire, ses ressources, ses expertises.
Résultat ? Un fonctionnement en silos qui bride la circulation des idées, ralentit la prise de décision et freine l’émergence de solutions transversales. Dans un environnement de plus en plus complexe, cette rigidité devient un handicap majeur.
La force organique des communautés
À l’inverse, une communauté se structure autour d’un projet fédérateur qui transcende les logiques départementales. Elle fonctionne selon des principes radicalement différents :
- Adhésion volontaire : les membres rejoignent la communauté par conviction, pas par obligation hiérarchique
- Gouvernance participative : les décisions émergent du collectif plutôt que d’être imposées par une autorité
- Intelligence distribuée : chaque membre contribue selon ses compétences, sans considération de statut ou de niveau
- Finalité téléologique : la cohérence vient du projet commun, non de la perpétuation d’une structure
Le management transversal comme pont
Cette opposition n’implique pas de tout détruire. Le management transversal peut servir de passerelle entre ces deux mondes : maintenir l’efficacité des structures existantes tout en créant des espaces de collaboration qui échappent aux logiques de silos.
Concrètement, cela signifie :
- Constituer des équipes projets temporaires qui mélangent les expertises
- Développer des réseaux internes qui favorisent l’échange de bonnes pratiques
- Créer des communautés d’innovation autour d’enjeux stratégiques transverses
L'enjeu culturel majeur
Le vrai défi n’est pas technique, il est culturel. Passer d’une logique de contrôle hiérarchique à une logique de facilitation collective exige de repenser fondamentalement le rôle du management.
Dans mes accompagnements, je constate que les dirigeants les plus efficaces sont ceux qui acceptent de lâcher prise sur le “comment” pour se concentrer sur le “pourquoi” et le “vers où”. Ils deviennent des facilitateurs qui créent les conditions de l’émergence plutôt que des contrôleurs qui dictent les solutions.
Les signaux faibles d'une transformation
Observez votre organisation : où voyez-vous naître spontanément des collaborations informelles ? Quels sont les projets qui fédèrent au-delà des frontières départementales ? Ces communautés émergentes sont souvent les laboratoires de l’innovation future.
L’enjeu n’est pas de les institutionnaliser (ce qui les tuerait), mais de leur donner les moyens de s’épanouir : temps, espaces, outils, reconnaissance.
Dans vos organisations, avez-vous observé des tensions entre logique hiérarchique et dynamiques communautaires ? Comment faites-vous cohabiter l’efficacité des structures existantes avec l’agilité des collectifs transverses ?
Peut-être que l’organisation de demain ne sera ni purement hiérarchique ni totalement communautaire, mais un savant équilibre entre ces deux forces complémentaires.
Inspiré par les réflexions de Belkacem Ammiar dans “Intelligence collective” (Editions Eyrolles).